Dans la Manche, le trait de côte suivi et analysé grâce à la donnée
Avec 674 km de côtes, le Département de la Manche est particulièrement exposé à la montée des eaux et au recul de ce qu’on appelle le trait de côte. En complément des mesures scientifiques, le Conseil Départemental met en place en 2024 un Observatoire Citoyen du Littoral Manchois fondé sur les contributions des habitants et des touristes.



Entretien avec Clément Nalin, Ingénieur Risques naturels littoraux et inondations au Conseil Départemental

Ce projet est présenté par :
- Clément Nalin, Ingénieur Risques naturels littoraux et inondations au Conseil Départemental
Parole de collectivité
Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets numériques, data et IA sur votre territoire, Numérique360 part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action
La Presqu’île du Cotentin redeviendra-t-elle de notre vivant une île ? Si la question se pose, c’est que le Département de la Manche est particulièrement exposé à la montée des eaux et au recul de ce qu’on appelle le trait de côte. Plus de 30 000 hectares de terres sont déjà situés sous le niveau de la mer pour un événement d’occurrence centennale. Avec une élévation d’un mètre, s’y ajouteront pas moins de 10 000 hectares de zones vulnérables supplémentaires. Face à la force de ce phénomène, le Conseil Départemental vient de lancer une démarche collaborative qui vise autant à collecter des données précises sur les évolutions qu’à impliquer activement les habitants et à les sensibiliser aux changements climatiques.
Comment le projet d’Observatoire citoyen du littoral manchois s’est-il imposé à l’agenda de votre collectivité ?
Dès 1991, le Département de la Manche a mis en place avec l’Université de Caen, un suivi géomorphologique du littoral. Ce partenariat reposait d’abord sur l‘implantation d’un réseau de pieux sur les plages nécessaire aux relevés au tachéomètre puis au DGPS [Differential Global Positioning System, GPS amélioré]. Avec les évolutions technologiques, nous sommes rapidement passés à l’exploitation de levés LiDAR. Cette technologie utilise des faisceaux laser pour mesurer les distances et créer des modèles en trois dimensions très précis.
Au bout de 30 ans, cette collaboration prenant fin, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de poursuivre ce suivi et sur la complémentarité possible avec les nouveaux réseaux apparus entre-temps, comme le Réseau d’Observation du Littoral Interrégional de Normandie et des Hauts-de-France. Nous avons également réfléchi au moyen de collecter davantage de données tout au long de l’année.
Nous avons enfin posé l’hypothèse que les collectivités avaient besoin de plus de connaissances pour mieux évaluer leurs projets et interventions sur le littoral, et qu’elles avaient également besoin d’accompagnement pour sensibiliser les citoyens et développer des stratégies d’adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?
Pour atteindre nos objectifs, deux solutions étaient possibles. La première aurait consisté à renforcer le dispositif de suivi scientifique, en multipliant par exemple le nombre de passages et parallèlement à communiquer nos résultats aux citoyens.
La seconde était de faire des citoyens des acteurs à part entière de la collecte des données. Nous avons donc étudié les dispositifs existants et découvert le procédé CoastSnap, développé en Australie et introduit en France en 2019. Ce dispositif permet de mettre en place des Observatoires Citoyens du Littoral, comme cela a été fait dans le Golfe du Morbihan par l’Université de Bretagne Sud.
Nous avons décidé de mettre en place ce type d’équipement et de développer un outil complémentaire, baptisé Alti’Plage, basé sur nos stations d’observation existantes, matérialisées par les fameuses bornes en bois, pour créer un indicateur citoyen d’évolution des niveaux de sable.
Le CoastSnap repose sur des supports fixes pour smartphones qui permettent de prendre des photos alignées et de générer des indicateurs à partir de ces images. Alti’Plage se base quant à lui sur une analyse comparative de photos prises par les citoyens, avec des finalités et des indicateurs différents.
Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?
L’impact environnemental du projet est limité. Le Département disposait déjà d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime (DPM) pour les pieux sur les plages.
Pour les stations CoastSnap, une autorisation a été demandée pour les ouvrages situés dans le DPM. À celle-ci s’ajoute parfois l’autorisation des gestionnaires, à savoir de la commune si le site est situé sur le domaine public communal ou le cas échéant de l’association syndicale autorisée (ASA).
Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?
Le Département seul n’aurait pas pu se lancer dans ce projet. Une station CoastSnap nécessite une mise en place spécifique avec un appui scientifique, soit avec un bureau d’études, soit avec un partenaire d’enseignement supérieur ou un laboratoire de recherche. Nous nous sommes orientés vers cette deuxième option. En l’occurrence, il s’agit du Cnam Intechmer basé à Cherbourg-en-Cotentin, dépendant du laboratoire universitaire de Sciences Appliquées de Cherbourg, lui-même dépendant de l’Université de Caen.
Nous maintenons aussi un partenariat universitaire avec des spécialistes et des géomorphologues qui vont nous aider à faire l’interprétation. Autre point essentiel, les outils et algorithmes sont en open source. Il y a donc vraiment une communauté avec des plateformes d’échange qui permet de partager sur la signalétique et les programmes.
Pour ce qui nous concerne, un recrutement est en cours pour avoir un opérateur technique qui fera les traitements d’images.
Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?
Un des enjeux était pour nous d’identifier les bons emplacements et le nombre idoine de stations. Nous verrons dans le temps si nous n’avons pas été trop ambitieux. À l’inverse, nous devrons aussi nous poser la question si nous avons trop de contributions et faire des choix. Sur d’autres territoires, ils ont d’abord expérimenté avec une, deux, ou trois stations. Après avoir constaté que cela fonctionnait, ils ont étoffé leur dispositif. L’appui scientifique et le réseau de pieux préexistant nous ont confortés dans l’idée de couvrir directement tout le littoral.
Concernant l’adhésion, une des volontés des élus est de faire connaître le dispositif dans les collèges du littoral. La plupart d’entre eux se trouveront en effet, à terme, à proximité d’une station CoastSnap ou d’une station Alti’Plage.
Tout est à écrire, mais les établissements pourraient s’approprier ces stations et en faire des outils pédagogiques pour sensibiliser les adolescents et les enfants. L’idée est d’avoir un travail spécifique sur ce volet d’observation du littoral.
Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?
Le coût total du projet est estimé à 417 000 €. Ce montant inclut le personnel qui sera recruté spécifiquement pour ce projet, ainsi que le personnel identifié au Cnam qui ne fait pas partie du personnel permanent déjà financé, mais qui contribuera de son temps. Il couvre également les coûts de fonctionnement, les investissements, les moyens numériques, le temps de formation, etc.
Sur cette somme, environ 52 % sont à la charge de l’Agence de l’eau, 22 % à la charge du Département et 26 % à la charge du Cnam. Nous avons des garanties financières sur trois ans et demi.
Profitez d’une offre de financement des projets numériques, data et IA de votre collectivité

Le projet en détails
Dates clés
2021
2022
2023 - 2024
Septembre 2024
Chiffres clés
157
33
19 000
À retenir
La complémentarité entre les couvertures lidar par avion et les contributions d'observateurs du littoral. Le réseau d'observation littoral fait des levés très précis tous les quatre ans. Avec Alti'Plage et CoastSnap, on ne remplace pas, mais on densifie les mesures, ce qui renforce l'efficacité.
Production de données : la Manche, c’est 500 000 habitants et 3,5 millions de visiteurs. Nous avons donc une capacité phénoménale à produire des données sur notre littoral. Ce projet est clairement fédérateur. Tous les retours que nous avons sont très positifs. Nous n’avons pas eu de difficulté pour obtenir les accords nécessaires. Et certains auraient même aimé qu'il y ait davantage de sites. C'est une action concrète, visible et compréhensible par le plus grand nombre. De plus, on n'a pas besoin d'être un expert. Pour peu qu'on s'intéresse au sujet, on peut contribuer.
Si la démarche semble simple sur le papier, elle nécessite une véritable expertise. Il faut pouvoir structurer la collecte et la bancarisation des photos. Concrètement, cela passe par le développement d’un système de prétraitement de ces dernières afin de limiter le risque chronophage. Un autre aspect concerne les aléas de la collecte. Nous nous attendons à avoir in fine un nombre de photos différent d’un site à l’autre. Les raisons peuvent être très diverses : fréquentation touristique, présence d’habitants très impliqués et fortement contributeurs, accessibilité, etc.
Les partenaires de ce projet

Département de la Manche

Cnam Intechmer
En savoir plus sur le Département de la Manche
Nombre d'habitants
Données de contact
Les autres projets - Transition écologique et énergétique
Un service d’accueil multicanal et chatbot grâce à l’IA à Suresnes (92)
Une offre départementale de services numériques mise en place par Essonne Numérique (91)


L’IA au service de la rénovation énergétique à Bordeaux Métropole (33) : le projet STACOPTIM


Une gestion durable de l’eau grâce au capteurs et réseau IoT à Lambersart (59)


La data au cœur de l’optimisation de la collecte des déchets à Pays de Montbéliard Agglomération (25)


Avec l’outil Le Cadran, SixFoisSept analyse l’attractivité de Laval Agglomération (53)
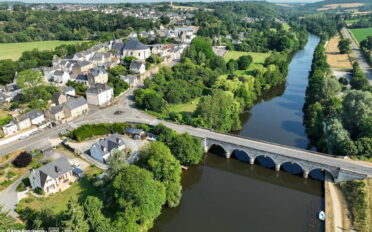

Vous êtes passés à l'action sur les données territoriales ?


