La Sarthe détecte les départs de feux avec des caméras et de l’IA
Afin de détecter les départs de feux, le Département de la Sarthe a installé une cinquantaine de caméras connectées en fibre optique sur les points hauts de son territoire. Grâce à ce dispositif permettant au SDIS d’intervenir plus rapidement et plus efficacement lors des épisodes d’incendie, plusieurs centaines d’hectares de forêt ont déjà été sauvés.



Entretien avec Martine Crnkovic, vice-présidente du Conseil Départemental en charge du numérique

Ce projet est présenté par :
- Martine Crnkovic, vice-présidente du Conseil Départemental en charge du numérique, vice-présidente de la Communauté de communes du Pays sabolien, maire de Louailles, vice-présidente de Sarthe Numérique et vice-présidente du SDIS 72
Parole de collectivité
Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets numériques, data et IA sur votre territoire, Numérique360 part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action
Face à l’augmentation du nombre de feux de forêt ces dernières années, le département de la Sarthe a décidé de s’équiper d’un dispositif de détection des départs de feux. Une cinquantaine de caméras connectées ont été installées sur 16 points hauts du territoire (9 pylônes et 7 châteaux d’eau). Précisément, deux caméras de détection de fumée sont positionnées sur chaque point haut. La première prend une photo toutes les 10 secondes en couvrant un azimut de 180°. Les images sont analysées par un algorithme d’IA qui compare chaque nouvelle photo à des images de référence. Lorsqu’une anomalie est détectée – comme la présence de fumée – la 2ème caméra, pilotable à distance et pouvant zoomer jusqu’à 40 km, est utilisée par le SDIS pour la levée de doute. Depuis son installation, ce dispositif a permis, selon le département, de sauver plusieurs centaines d’hectares de forêt.
Comment le projet de détection des départs de feux s’est-il imposé à l’agenda de votre collectivité ?
Avec 117 000 hectares de forêt, le département de la Sarthe est le plus boisé de la région Pays de la Loire. Au cours des dernières années, nous nous sommes rendu compte que le risque de feux de forêt, qui concernait auparavant essentiellement les départements du sud de la France, devenait une réalité dans la Sarthe. D’autant plus que ce risque pèse également sur les cultures car notre territoire est en grande partie rural.
Notre réflexion a débuté en 2015, après les incendies de Mulsanne qui ont détruit 105 hectares de forêt et coûté 500 000 € au SDIS. Depuis, nous observons de nombreux départs de feux chaque année, surtout depuis 2019. Le SDIS réalise 400 interventions par an en moyenne pour des feux de végétation. Lors des épisodes les plus importants, tous nos moyens de lutte contre le feu et de secours sont engagés. En juillet 2019, 353 pompiers ont œuvré pour venir à bout de 25 incendies d’espaces naturels, dont 5 feux de forêt. En septembre 2020, 446 pompiers étaient engagés pendant 6 jours pour sauver la forêt de Bercé.
Nous avons décidé de prendre le problème à bras le corps et recherché une solution de détection des départs de feux afin de pouvoir sauver des surfaces d’espaces naturels. En effet, en connaissant la nature et la localisation précise des feux, le SDIS peut intervenir plus rapidement. De plus, il peut envoyer le dispositif matériel adapté (type et nombre d’engins). Il faut noter que nous disposions déjà de l’infrastructure réseau nous permettant d’acheminer les données en temps réel au centre de supervision (le réseau en fibre optique déployé couvrait déjà tous les points hauts). La société Paratronic, qui a remporté l’appel d’offres, a donc pu installer et connecter directement les caméras de détection.
Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?
Lorsque nous nous sommes mis en recherche d’une solution répondant à nos attentes, nous avons découvert que certains départements (Charente-Maritime, Landes, Var, Lot-et-Garonne…) avaient déjà déployé des caméras pour surveiller leurs forêts. Nous avons organisé des réunions avec les sapeurs-pompiers de ces collectivités afin d’en savoir plus sur les solutions techniques utilisées.
Paratronic avait installé le dispositif dans les Landes mais en s’appuyant sur un réseau hertzien. De notre côté, nous souhaitions absolument mettre à profit notre couverture en fibre optique. Par conséquent, nous avons insisté auprès du prestataire pour qu’il adapte son savoir-faire dans la Sarthe, ce qui fut fait en collaboration avec les services de Sarthe Numérique. Ainsi, la Sarthe est devenue le premier département au nord de la Loire à disposer de caméras de surveillance de la forêt.
Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?
Non, nous n’avons pas lancé d’étude de faisabilité car nous étions certains de la pertinence de la solution que nous souhaitions déployer. Finalement, la seule étude que nous avons réalisée a été destinée à nous assurer que nous disposions de suffisamment de points hauts pour couvrir l’intégralité de la canopée sarthoise. Cela nous a évité d’avoir à construire de nouveaux pylônes, ce qui aurait constitué un coût supplémentaire très important.
Ensuite, il a fallu que le fournisseur de caméras valide le basculement de sa solution sur la fibre optique. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre Paratronic, Sarthe Numérique et les sapeurs-pompiers à ce sujet.
Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?
Tout d’abord, les compétences de gestion du réseau de communication sont essentielles. Le savoir-faire technique de Sarthe Numérique en matière de fibre optique a constitué un atout très précieux.
Ensuite, le positionnement des caméras revêt lui aussi une importance toute particulière puisqu’il doit permettre de couvrir l’ensemble du périmètre à surveiller. Au regard des capacités du matériel fourni, nous avons proposé des points hauts à Paratronic qui les a étudiés et validés. À noter que, sur ce sujet, les syndicats en charge des châteaux d’eau ont parfaitement joué le jeu.
Enfin, il faut également souligner que les compétences et l’expérience des sapeurs-pompiers en matière de reconnaissance de feux sont fondamentales. En effet, les caméras prennent des photos toutes les 10 secondes et alertent en cas d’anomalie, mais parfois de simples fumerolles ou même de la poussière soulevée par un engin agricole peuvent être à l’origine des alertes. L’œil humain et la caméra de levée de doute permettent de confirmer ou non la détection d’un véritable départ de feu.
Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?
En ce qui concerne le dimensionnement, le fournisseur nous a indiqué dans un premier temps les surfaces que pouvaient couvrir ses caméras. Cela nous a aidé à sélectionner les points hauts sur lesquels il s’avérait pertinent de les installer. Aujourd’hui, nous surveillons non seulement l’intégralité de la canopée sarthoise, mais également une partie de la forêt des départements voisins, à savoir le Maine-et-Loire, la Mayenne, l’Orne, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Par ailleurs, nous avons veillé à pouvoir également surveiller les cultures.
Nous n’avons pas eu d’opposition sur ce projet, puisque les citoyens ont très rapidement compris l’intérêt que représentait ce dispositif, à un moment où les feux de forêt commençaient à se multiplier sur notre territoire en période estivale. D’autant plus que nous n’avons utilisé que des équipements publics déjà présents pour mettre en place le dispositif. Nous nous sommes simplement engagés à surveiller uniquement la canopée et à ne pas utiliser l’équipement pour d’autres objectifs. Nous n’avons pas rencontré non plus de difficulté à convaincre les forestiers qui ont vu d’un bon œil le déploiement d’une solution ayant vocation à sauvegarder leur forêt.
Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?
Le coût total du projet se monte à 1,2 million d’euros HT. Le système a été financé par une subvention d’investissement versée par le département à hauteur de 60 % du montant global et par Le Mans Métropole à hauteur de 40 %. Le SDIS a assuré la maîtrise d’ouvrage du projet et le financement en fonctionnement (environ 120 000 € par an). Nous n’avons pas bénéficié d’aides ou subventions de l’Etat. Mais, aujourd’hui, nous aurions sans doute droit au fonds vert.
Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné le département de la Sarthe dans la préparation et la réalisation de ce projet (acteurs publics et privés, bureau d’étude, associations, entreprises TP…) ?
Le département de la Sarthe, la communauté urbaine du Mans, le SDIS 72 et le fournisseur Paratronic sont les acteurs impliqués dans ce projet. Il faut dire que lorsque nous avons déployé le dispositif, il revêtait un caractère de nouveauté. En fait, aujourd’hui, c’est nous qui sommes consultés par d’autres collectivités souhaitant obtenir des renseignements. Nous en recevons 2 à 3 chaque année sur ce sujet. Par ailleurs, les départements voisins sont en cours de réflexion pour adopter le même type de solutions.
Profitez d’une offre de financement des projets numériques, data et IA de votre collectivité

Le projet en détails
Dates clés
2015
2019
2019
2021
Chiffres clés
16
1,2
6
À retenir
Grâce à un procédé de triangulation, les pompiers localisent rapidement et précisément l’incendie.
Le dispositif apporte suffisamment d’information pour aider les SDIS à adapter son dispositif de secours (type et nombre d’engins).
La solution nécessite tout de même la mobilisation de personnel pour surveiller les images au centre de supervision.
Les partenaires de ce projet

Communauté urbaine du Mans

SDIS 72
Les acteurs de la filière data / numérique / IA impliqués dans ce projet
Paratronic
Nombre d'habitants
Données de contact
Les autres projets - Transition écologique et énergétique
Une gestion durable de l’eau grâce au capteurs et réseau IoT à Lambersart (59)
La data au cœur de l’optimisation de la collecte des déchets à Pays de Montbéliard Agglomération (25)


Avec l’outil Le Cadran, SixFoisSept analyse l’attractivité de Laval Agglomération (53)
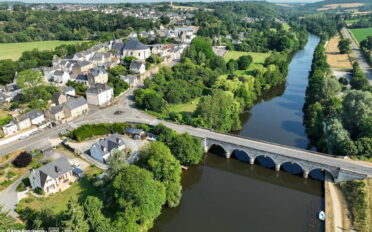

Le Jumeau Numérique de la Vendée (85) : Innover avec la Data


Un dispositif de gestion technique centralisée (GTC) à Vannes (56) permet d’optimiser les performances énergétiques de 70 bâtiments


La Communauté d’agglomération de Valenciennes (59) lance un plan d’action pour une logistique urbaine durable


Vous êtes passés à l'action sur les données territoriales ?


