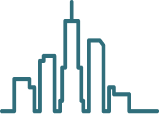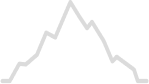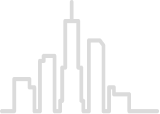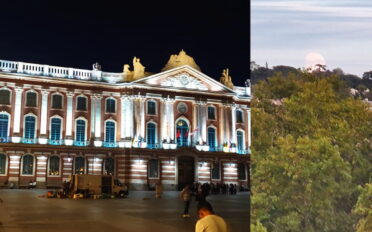La récupération de la chaleur fatale issue des data centers offre une solution d’énergie décarbonée, locale et peu couteuse. Elle contribue à la transition des territoires et au pouvoir d’achat des habitants.
Qu’est-ce que la chaleur fatale ?
L’ADEME définit la chaleur fatale comme une « chaleur générée par un procédé qui n’en est pas la finalité première et qui n’est pas nécessairement récupérée ». Si elle est réutilisée, on parle alors d’« énergie de récupération ».
La chaleur fatale provient d’un site ou d’un bâtiment qui utilise beaucoup de chaleur pour fonctionner. Il s’agit, par exemple, d’un site d’incinération des déchets, d’une usine de production, ou encore d’un bâtiment tertiaire tel qu’un hôpital ou une école.
Sa forme, sa qualité et ses caractéristiques dépendent grandement de la source dont elle provient. Par exemple, la chaleur fatale d’un data center a la particularité d’être relativement stable et peu réactive aux températures.
Pourquoi récupérer la chaleur fatale des data centers ?
Les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Afin de répondre à l’objectif de neutralité carbone en 2050 prévue par la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), elles doivent redoubler d’ingéniosité pour diversifier leurs sources d’énergie et s’y adapter.
En France, en 2023, l’empreinte carbone des data centers représentait 16 % des émissions liées au numérique (ADEME). Par ailleurs, l’ADEME estime que ces infrastructures consommeront deux fois plus d’énergie d’ici à 2030.
Dans ce contexte, récupérer la chaleur fatale d’un data center permet d’accéder à une énergie sobre et renouvelable, tout en limitant la pollution due à la chaleur.
Maitriser les dépenses énergétiques des collectivités grâce à la chaleur fatale
Son utilisation offre de nombreux avantages : contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et à la lutte contre le changement climatique, réduire la facture liée à l’énergie pour la collectivité et les habitants, ou encore favoriser la souveraineté énergétique et la centralisation des données. Plus largement, un projet de récupération peut encourager la création d’emplois locaux dans le numérique, et ainsi, à faire rayonner le territoire.
La mise en place d’un réseau de récupération de la chaleur fatale offre aussi une opportunité de créer des ponts entre le monde industriel, les collectivités et les entreprises, car elles doivent impérativement travailler ensemble. Elle crée ainsi une logique de circularité et de solidarité au sein du territoire.
Implémenter un projet de récupération de la chaleur fatale : une démarche de concertation
Parce qu’elle est vivante, la particularité de cette énergie est qu’elle dépend complètement des conditions techniques, géographiques et de la manière dont on l’exploite. C’est pourquoi le dialogue constant entre les différents acteurs impliqués (collectivité, exploitant, opérateur du data center, EPCI, syndicat d’énergies, habitants) est déterminante.
Quelles sont les étapes de mise en œuvre ?
Étape 1 – Mettre le sujet à l’agenda de votre collectivité. Un projet d’installation ou de rénovation d’un data center prend entre 2 et 5 ans.
Étape 2 – Identifier les bons interlocuteurs. La qualité du dialogue entre les acteurs impliqués est un élément clé et doit s’entamer dès les premières étapes du processus.
Étape 3 – Réaliser une étude de faisabilité sur le plan écologique, technique et économique. La chaleur fatale étant une énergie mouvante, la pertinence d’un projet de récupération repose sur la capacité à exploiter au mieux son potentiel, au regard des besoins.
Étape 4 – Définir l’emplacement idéal pour accueillir le nouveau data center. Il doit prendre en compte les besoins (proximité avec les réseaux télécoms disponibles) et/ou des avantages (stocker localement les données tout en facilitant leur accès, par exemple).
Étape 5 – Se renseigner sur la règlementation relative à la chaleur fatale. En effet, celle-ci est soumise à plusieurs directives qui varient en fonction de la taille de l’installation, ainsi que de l’évolution de la règlementation aux niveaux européen et national. Depuis 2015, l’installation ou la rénovation d’un site requiert, par exemple, de fournir des preuves quant à sa capacité de valorisation.
Étape 6 – Se renseigner sur les aides et les subventions.
Étape 7 – Intégrer le projet au sein d’un document de planification urbaine afin de garantir une stratégie énergétique du territoire cohérente.
Étape 8 – Définir la structure de portage du projet, de l’investissement à l’exploitation.
Étape 9 – Contractualiser le projet.
Étape 10 – Valoriser l’expérience auprès d’autres collectivités pour les inspirer.
Comment mesurer la réussite de l’action ?
- La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a défini l’objectif d’injection de 8.75 TWh / an en 2028 (contre 5 TWh / an en 2020) ;
- En 2023, le potentiel de chaleur fatale (estimation de la capacité des data centers à produire de l’énergie) en France était estimé à 1TWh environ. Cela prenait en compte 200 centres numériques dédiés et 5000 serveurs d’appoints. En 2030, le potentiel récupérable pourrait représenter 3,5 TWh grâce aux progrès technologiques.