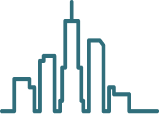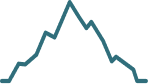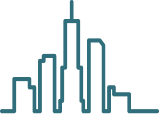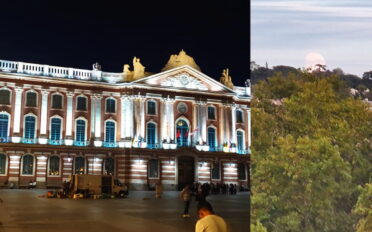Résorber les dépôts sauvages est un enjeu environnemental, social et économique. Vidéo-surveillance, drones, satellites, le tout couplé avec de l’IA, sont de nouveaux atouts pour combattre ce fléau grandissant.
Comment lutter contre les dépôts sauvages ?
Qu’ils soient effectués par des entreprises ou des citoyens peu scrupuleux, les dépôts sauvages sont une préoccupation croissante pour les collectivités locales. Pollution des sols, détérioration du paysage urbain ou rural, insalubrité de l’espace public sont autant de défis auxquels les collectivités sont confrontées. Pour engager une politique de réduction de ces dépôts, encore faut-il les recenser, les localiser, pour pouvoir mener les actions d’enlèvement et éviter leur déplacement vers d’autres sites. En fonction des objectifs de la collectivité, une gamme de solutions techniques peut être déployée pour les localiser. Avec les outils de reconnaissance d’image proposés par l’IA, on peut à la fois les recenser sur le territoire, et tenter d’identifier les auteurs de ces dépôts illicites.
Faire de l’analyse d’images grâce aux caméras et à l’IA
Certains points de dépôts sauvages sont connus de tous. Ce sont par exemple des dépôts effectués à proximité des Points d’Apport Volontaire, lorsque les containers sont pleins (ou pas), ou bien dans des terrains vagues en périphérie d’agglomération. Dans ce cas, l’installation de caméras permettra aux agents de visualiser le dépôt au plus tôt afin d’envoyer une équipe d’enlèvement. Par simple reconnaissance des plaques minéralogiques, ou par identification des véhicules, des algorithmes IA permettent par ailleurs d’engager des actions de police auprès des suspects. Ce type de solution a déjà été déployé notamment à Bourges, Porto Vecchio, Valbonne ou encore Vernon. Mais si les caméras fixes ont un pouvoir dissuasif auprès des contrevenants, elles auront aussi pour effet collatéral de faire fuir ces dépôts sauvages… vers des zones non encore équipées de caméras.
Déployer des caméras mobiles semble être un dispositif plus à même de couvrir un périmètre qui peut fluctuer dans le temps. C’est ce qui a été fait notamment à Marseille ou à Montélimar avec des caméras déplacées de site en site. Pour aller plus loin dans la mobilité, moyennant l’autorisation du Préfet, l’utilisation de caméras embarquées sur des drones peut être envisagée, en référence au Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.
Lorsque la collectivité couvre plusieurs communes, le drone peut se révéler insuffisant. On peut alors utiliser des images satellitaires à très haute définition, grâce auxquelles les algorithmes de reconnaissance d’image pourront détecter des dépôts sauvages déjà connus, mais surtout inconnus, par exemple sur des terrains de particuliers ou dans des zones peu accessibles. Cette technologie a été utilisée en Région PACA et aussi dans le Val d’Oise, ce qui permis d’identifier en 2 ans sur le département plus de 600 décharges totalement inconnues des collectivités.
Quels avantages pour la collectivité ?
- Réagir rapidement par suite de dépôts sauvages : diligenter des équipes de nettoyage avant que le dépôt ne devienne incontrôlable, et réduire les coûts liés aux enlèvements de dépôts sauvages ;
- Eviter la pollution des terrains : infiltration des nappes phréatiques, dépôts de matériaux toxiques, obstruction des voies d’assainissement, arrivée de rongeurs, dégradation des milieux naturels ;
- Protéger les citoyens résidant à proximité de la pollution visuelle, des nuisances olfactives liées aux dépôts sauvages ;
- Engager des actions auprès des contrevenants pour endiguer les dépôts illicites.
Quels avantages pour les citoyens ?
- Résider dans une commune plus propre, plus accueillante, plus sécurisée ;
- Bénéficier d’une taxe locale plus clémente sur les ramassages des ordures.
Quels sont les moyens à mettre en place ?
Moyens humains : les représentants de la collectivité, dont les services Déchets et les forces de police si l’objectif est de déclencher des poursuites à l’égard des contrevenants. Identifier les agents au sein du Centre de Supervision Urbain – s’il existe – qui auront la charge de la surveillance des dépôts sauvages, de la relation avec les équipes de Gestion des Déchets, et potentiellement avec les forces de l’ordre en cas de poursuites. Il faut également disposer de ressources qui vont analyser tous les aspects réglementaires et juridiques liés à la capture et au traitement d’images.
Moyens technologiques : Quelques solutions d’IA spécialisées dans la détection de déchets et dépôts sauvages, dont certaines françaises, voient le jour. Ce sont en majorité des offres de plateformes qui hébergent les algorithmes d’analyse des images et les outils de visualisation mis à disposition des agents de la collectivité. À partir des séquences vidéo les agents disposent ainsi de tous les éléments pour transmettre, au Maire ou au Procureur, un rapport contenant les preuves nécessaires pour engager une procédure pénale ou administrative.
Certaines solutions proposent la détection et le suivi des décharges sauvages à partir d’images satellitaires à très haute résolution et de données thermiques. Ces outils estiment alors le volume des dépôts et leur évolution dans le temps.
Moyens financiers : pour une solution simple à base de caméras fixes ou mobiles, le coût annuel est de l’ordre d’environ 10 000 € pour la location d’une caméra, son installation et sa maintenance
Avec une solution sur la base d’images satellitaires, le coût annuel pour le Val d’Oise est de 120.000 € par an (50.000 pour les photos satellites et 70.000 pour l’usage de la plateforme)
Quelles sont les étapes de mise en œuvre ?
Étape 1 – Choix des objectifs assignés à la détection des dépôts sauvages : sur quel périmètre géographique, quels moyens humains, quelle volonté d’engager des procédures pénales ou administratives, quelle estimation des revenus attendus avec les amendes infligées aux contrevenants
Étape 2 – Sélection des solutions techniques : identification des offreurs, lancement d’un appel d’offres
Étape 3 – Installation de la solution et formation des agents
Comment mesurer la réussite de l’action ?
- Nombre de nouveaux dépôts sauvages identifiés ;
- Nombre de dépôts ayant disparu ;
- Volume des dépôts illégaux ;
- Économies réalisées sur les collectes.